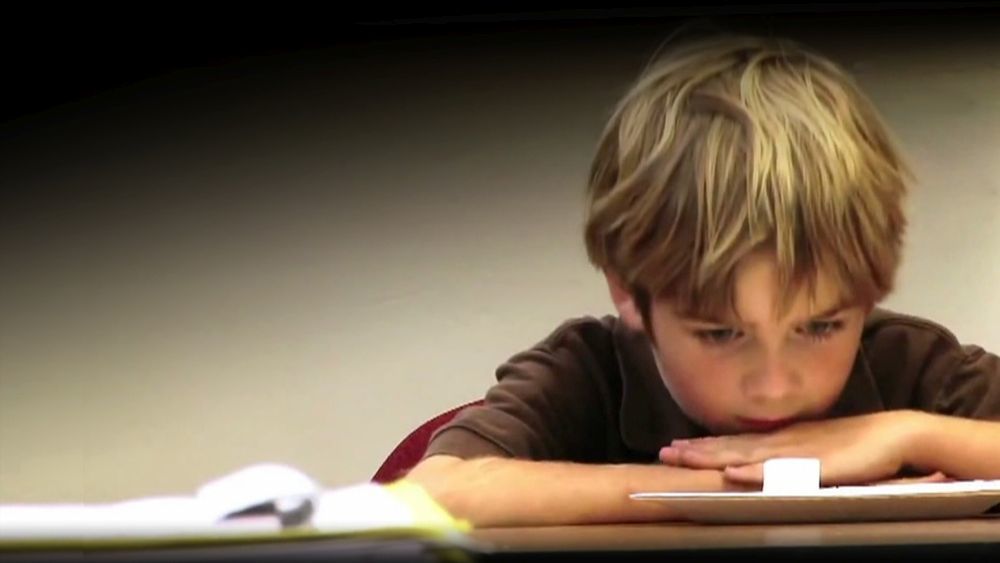
Thomas (noms fictifs) était un avocat très efficace et calme qui s'inquiétait de sa dépendance à l'alcool. Quand il est venu me voir pour une séance de psychothérapie, il a consommé 6-7 verres de vin par soir, et il commençait déjà à cacher cette habitude à la maison et à sentir son influence sur son travail. Nous avons discuté des stratégies de traitement et pris un nouveau rendez-vous. Mais à son retour deux semaines plus tard, il était complètement déprimé: rien n'a changé avec la consommation d'alcool.
«Je ne peux tout simplement pas me limiter. Je suppose que je n'ai pas de volonté. "
Un autre patient, John, est également venu me voir au début à cause de la dépendance à l'alcool. Lors de la première réunion, nous avons discuté des approches basées sur la modération et des restrictions plus saines. Mais un mois plus tard, il est venu me voir pour déclarer qu'il avait changé d'avis et qu'il s'était réconcilié avec ses habitudes alcooliques. Sa femme n'était pas toujours satisfaite de la quantité d'alcool qu'il buvait, et parfois il souffrait d'une gueule de bois, mais la relation était assez forte et l'alcool ne lui causait pas de graves problèmes.
En fait, John et Thomas sont similaires: ils ont tous deux succombé à la tentation à court terme et n'ont pas pu supporter leurs aspirations à long terme. Mais Thomas a attribué l'échec aux problèmes de volonté, et John a redéfini son comportement dans une perspective qui rejette complètement le concept de volonté. John et Thomas résoudront leurs problèmes en conséquence, mais de manières très différentes.
La plupart des gens aimeraient l'explication de Thomas. Ils seront d'accord avec son auto-diagnostic (manque de volonté), et l'appelleront même objectif et audacieux. Il semblera à beaucoup que la révision de John de son problème était simplement une auto-illusion, cachant le vrai problème. Mais l'approche de Thomas doit être traitée avec autant de scepticisme que l'approche de John. Il est possible que Thomas ait été séduit par le statut presque mystique de volonté qui lui a été donné par la culture moderne - et cette idée a donc été contre lui.
Pour la plupart des patients et des psychologues, ignorer l'idée de volonté semblera absurde, mais moi, en tant que psychiatre praticien spécialisé dans les addictions et professeur adjoint de psychiatrie clinique, je suis de plus en plus sceptique quant au concept de volonté et je m'inquiète de l'obsession de l'épidémie d '«auto-assistance» . D'innombrables livres et blogs offrent des moyens «d'augmenter la maîtrise de soi» ou même «d'augmenter la volonté grâce à la méditation», mais peu admettent qu'une nouvelle étude a révélé que certaines des idées derrière ces méthodes étaient inexactes.
La définition généralement acceptée et fondamentale de la volonté nous distrait des petits détails de la maîtrise de soi et est dangereuse car elle peut gonfler des mythes nuisibles - par exemple, l'idée que la volonté est finie et peut être dépensée. Willpower est un concept mixte qui relie un large éventail de fonctions cognitives indépendantes. Plus nous la regardons, plus elle a l'air faible. Il est temps de s'en débarrasser complètement.
Les racines de la volonté et de la maîtrise de soi se développent dans la culture occidentale et remontent au début du christianisme lorsque des théologiens comme
Aurelius Augustine ont utilisé l'idée du libre arbitre pour expliquer comment le péché peut être comparé à une divinité omnipotente. Plus tard, lorsque les philosophes ont commencé à se distraire de la religion, les penseurs
des Lumières , en particulier
David Hume, ont tenté de concilier le libre arbitre avec les idées dominantes du déterminisme scientifique.
Le concept de volonté n'est apparu qu'à l'
époque victorienne , comme le décrit le chercheur en psychologie Roy Baumeister dans Willpower: Redécouvrir la plus grande force humaine. Au XIXe siècle, le déclin de la religion, l'augmentation de la population et la pauvreté généralisée ont entraîné des tensions sociales sur la question de savoir si les couches inférieures de la société étaient nécessaires pour maintenir des normes morales appropriées. La maîtrise de soi était une obsession de l'époque victorienne, annoncée par des publications telles que l'auto-assistance incroyablement populaire de 1859, qui promouvait la valeur de «l'altruisme» et la persévérance implacable. Les Victoriens ont adopté l'idée directement de la
révolution industrielle et ont décrit la volonté comme une force tangible qui alimente le moteur de notre maîtrise de soi. Ceux qui manquaient de volonté étaient méprisés. La première mention de ce mot, selon l'Oxford Dictionary, se produit en 1874 à propos de préoccupations moralisantes à propos de certaines substances: «Des ivrognes dont la volonté et la force morale étaient soumises à un appétit dégradé».
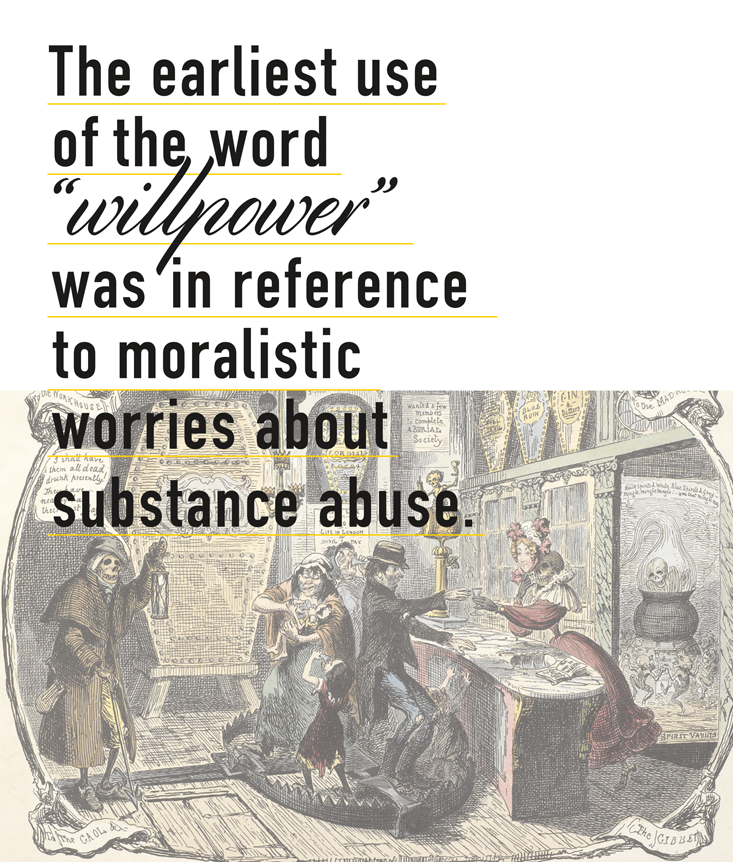
Au début du XXe siècle, lorsque la psychiatrie tente de s'imposer comme un espace légitime à fondement scientifique, Freud développe l'idée d'un «
surmoi ». Le surmoi, ou surmoi, est le plus proche parent psychanalytique de la volonté, représentant la partie critique et moralisante de la conscience apprise des parents et de la société. Il traite des fonctions de base de la maîtrise de soi - il dépense de l'énergie psychique en opposition à
id (it) - mais il est également associé à des jugements éthiques et évaluatifs plus larges. Bien que Freud soit souvent associé à un rejet des vues victoriennes, le surmoi représente une continuation quasi scientifique de l'idéal victorien. Vers le milieu du siècle
B.F. Skinner a suggéré qu'il n'y avait pas de liberté interne pour contrôler le comportement. La psychologie universitaire a suivi la voie du
béhaviorisme et le concept de libre arbitre a été abandonné.
Peut-être que l'histoire de la volonté se serait terminée là-dessus, si ce n'était de quelques découvertes inattendues survenues au cours des décennies suivantes, et ravivé l'intérêt pour la maîtrise de soi. Dans les années 1960, le psychologue américain Walter Michelle a décidé de tester comment les enfants font face à une récompense différée avant la tentation des bonbons dans sa fameuse "
expérience avec des guimauves ". Les jeunes sujets ont eu le choix entre une gâterie savoureuse immédiatement ou deux plus tard. Ce n'est que de nombreuses années plus tard, lorsqu'il a entendu des histoires sur la façon dont certains de ses sujets ont étudié et travaillé, qu'il a décidé de tous les trouver et de recueillir des données sur leurs réalisations. Il a constaté que les enfants capables de résister à la tentation étudiaient mieux et passaient les tests [1]. Cela a stimulé l'intérêt des scientifiques pour l'idée de «maîtrise de soi», le terme généralement accepté pour la volonté utilisée dans la recherche psychologique.
Ces travaux ont ouvert la voie à l'émergence d'une définition moderne de la volonté, qui est décrite dans les médias et dans le milieu universitaire comme la capacité de se maîtriser instantanément - la suppression consciente des impulsions et des désirs soudains. Ou, comme décrit dans un récent rapport des membres de l'American Psychological Association: "la capacité de résister aux tentations à court terme pour atteindre des objectifs à long terme". Cette possibilité est décrite comme une ressource discrète et limitée qui peut être épuisée, comme une sorte de source d'énergie. Le concept de ressources limitées, apparemment, est né des idées judéo-chrétiennes sur l'opposition aux désirs pécheurs et ressemble à une analogie naturelle avec d'autres propriétés physiologiques - telles que la force, l'endurance ou la respiration. Dans les années 1990, le psychologue Roy Baumeister a mené une expérience clé pour décrire cette possibilité, qu'il a appelée «épuisement de l'ego». Plusieurs étudiants ont dû résister à l'envie de manger des biscuits aux pépites de chocolat frais et ont plutôt mangé des radis, tandis que d'autres étaient libres de manger des biscuits. Les étudiants qui se sont mal illustrés dans l'expérience ont ensuite obtenu de moins bons résultats avec d'autres tests psychologiques, ce qui a conduit à la conclusion qu'ils avaient épuisé une certaine ressource cognitive limitée.
Soutenant les effets de l'épuisement de l'ego, la recherche aurait été reproduite des dizaines de fois, à partir desquelles divers livres bien vendus se sont développés (y compris le livre de Baumeister lui-même, Willpower) et des programmes de recherche sans fin. Mais la méta-analyse de 2015, dans laquelle ces études ont été soigneusement étudiées avec d'autres travaux inédits, a trouvé un très grand biais dans les travaux et très peu de preuves de la réalité du phénomène d'épuisement de l'ego [2]. Les psychologues ont ensuite mené une expérience internationale sur l'épuisement de l'ego, à laquelle plus de 2100 sujets ont participé. Les résultats récents ne confirment pas la réalité de ce phénomène [3]. Apparemment, c'est une autre victime de la crise de reproductibilité de la recherche psychologique.
Si l'épuisement de l'ego est réfuté, il est étonnant de voir à quel point il s'est fermement établi dans l'esprit avant qu'une recherche plus approfondie ait dissipé les hypothèses sur lesquelles il repose. L'histoire de son ascension et de sa chute montre comment de fausses hypothèses sur la nature de la volonté non seulement nous trompent, mais nous nuisent également. Des études connexes montrent que la foi en la volonté affecte la maîtrise de soi. Les sujets qui croyaient en la possibilité d'épuisement de l'ego (que la volonté de puissance est une ressource limitée) ont montré une diminution de la maîtrise de soi pendant l'expérience, et ceux qui ne croyaient pas en l'épuisement de l'ego sont restés inchangés. De plus, lorsque les sujets inconsciemment, à travers des indices dans les questionnaires, font allusion à la possibilité d'épuisement de l'ego, leurs résultats deviennent également pires.
Le problème du concept moderne de volonté va bien au-delà de l'épuisement de l'ego. Les simplifications scientifiques habituelles associées à la volonté sont en jeu. Dans un article cité en 2011, Kentaro Fujita a exhorté les psychologues à cesser de conceptualiser la maîtrise de soi comme une simple suppression coûteuse des impulsions et a encouragé ses collègues à penser plus largement en termes de motivation à long terme [4]. Par exemple, certains économistes comportementaux pensent que la maîtrise de soi ne doit pas être considérée seulement comme une suppression des désirs soudains, mais comme un processus de «commerce intrapersonnel»: une personne est en conflit avec plusieurs systèmes de prise de décision. Ce modèle permet de changer les priorités et les motivations au fil du temps - c'est exactement ce qui s'est passé avec John, qui a dit qu'il avait simplement reconsidéré sa vision des problèmes d'alcool, après avoir raconté tous les avantages et les inconvénients.
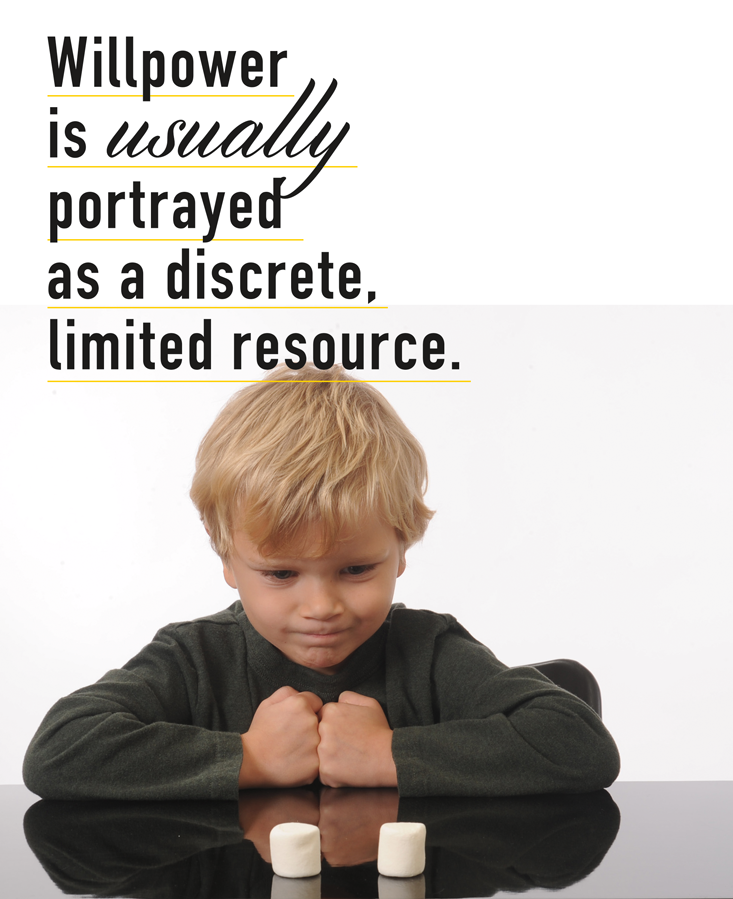
Un autre aspect non détecté de la maîtrise de soi est la gestion des émotions, un domaine scientifique qui s'est développé rapidement au cours des dernières décennies. Depuis le début des années 1990, le nombre d'œuvres citées a quintuplé tous les cinq ans. Cette composante de la maîtrise de soi est également ignorée du point de vue de la volonté comme un certain muscle qui domine dans les discussions modernes. Il devrait être intuitivement clair que les émotions sont une composante de la volonté. S'arrêter et ne pas crier sur un parent ennuyeux n'est pas la même chose que résister à l'envie de boire. L'autonomie gouvernementale émotionnelle est une fonction complexe et, comme nous le savons depuis longtemps dans le domaine psychologique, une tentative de contrôler votre état émotionnel par la force brute est vouée à l'échec. Au lieu de cela, la gestion des émotions comprend des compétences telles que le transfert d'attention (distraction), la modulation de la réponse psychologique (respiration profonde), la capacité de tolérer et d'attendre des émotions négatives, de changer les croyances.
Un exemple paradigmatique d'un changement de croyance est le phénomène de «remise différée», dans lequel les gens ont tendance à minimiser leurs récompenses futures, préférant des profits plus petits mais instantanés. Si vous offrez à une personne 5 $ maintenant ou 10 $ en un mois, beaucoup acceptent illogiquement des récompenses instantanées. Mais si vous reformulez la question, indiquant clairement un compromis: «Voulez-vous obtenir 5 $ aujourd'hui et 0 $ en un mois, ou 0 $ aujourd'hui et 10 $ en un mois?», Alors plus de gens choisissent une récompense importante, bien que différée. Des études montrent que reformuler une question pousse les gens à une récompense différée, car différentes versions de la question fonctionnent avec différents processus cognitifs. Dans une étude avec neuroimagerie, dans la deuxième version de la question, non seulement la réaction des parties du cerveau responsables de la récompense diminue, mais l'activité du cortex frontal dorsolatéral associée à l'autosurveillance nécessitant un effort diminue également [5]. Reformuler consciemment le problème de cette manière serait un exemple de volonté, mais ne tomberait pas dans la compréhension généralement acceptée du terme. Au lieu d'être basée sur un effort pour combattre les impulsions, cette volonté force l'individu à repenser le problème et à éviter le besoin même de se battre.
Ces aspects cachés de la volonté posent la question de la validité de l'ensemble du concept du terme dans son ensemble et nous conduisent à une situation où tout le monde perd. Soit notre définition de la volonté est trop étroite et simplifiée pour la futilité, soit elle peut être utilisée comme un terme inexact basé sur un mélange contradictoire de différents processus mentaux. La volonté peut être une idée préscientifique - née du raisonnement social et philosophique, non de la recherche, et chérie avant de pouvoir être vérifiée expérimentalement. Le terme a survécu dans la psychologie moderne, car il est intuitivement lié à notre imagination. La représentation de la volonté comme une sorte de force musculaire coïncide avec quelques exemples limités, tels que la résistance aux désirs, et cette analogie est renforcée par les attentes sociales, qui remontent à la moralisation victorienne. Mais ces idées destructrices nous distraient de façons plus précises de comprendre la psychologie humaine et même de nos tentatives de mener une maîtrise de soi significative. La meilleure façon d'aller de l'avant est d'abandonner complètement le concept de «volonté».
Cela abandonnera un lourd fardeau moral. Le concept de volonté est facile à étiqueter. Il devient permis de détruire le soutien social de la population, si l'on considère la pauvreté comme un problème de discipline financière, ou la santé comme une discipline personnelle. Un exemple extrême est l'approche punitive de notre guerre sans fin contre les drogues, qui élimine les problèmes liés à la consommation de drogues en raison de choix personnels. La moralisation malsaine pénètre les coins les plus banals de la société. Lorsque les États-Unis ont commencé à s'inquiéter des déchets dans les années 1950, l'American Can Company et d'autres sociétés ont parrainé la campagne Keep America Beautiful pour détourner l'attention du fait qu'ils produisent une énorme quantité d'emballages bon marché, jetables et rentables et transfèrent le blâme pour poubelle sur les individus. Le moyen le plus simple de lancer des accusations morales sur la volonté.
En conséquence, il n'est pas nécessaire de croire à la volonté. Quand j'entends «volonté», je reçois un drapeau mental rouge qui m'oblige à clarifier ce concept. Mon patient Thomas avait-il un problème de volonté? Quand il a lutté avec l'envie de boire, il n'a eu aucun problème de motivation positive, avec la poursuite d'une carrière et d'un sport extrêmement réussis - il a remporté plusieurs compétitions régionales à New York. Ses difficultés à réprimer l'envie de boire n'étaient pas liées à sa capacité à respecter le plan. Certains chercheurs appellent cette propriété «auto-discipline» et y distinguent le contrôle des impulsions ou la résistance aux tentations. Laquelle de ces fonctions cognitives est la «volonté»? Poser une telle question, c'est ne pas comprendre l'essence.
Il a bien fini. Lorsque nous avons examiné en détail les problèmes qui l'ont amené à boire, il est devenu clair qu'il ne comprenait pas combien le stress affecte sa vie. Non seulement il s'est torturé, croyant qu'il devait simplement se forcer à être attaché, mais il avait également des idées irréalistes sur ce qu'il devait accomplir au travail, à la maison et ailleurs. En se concentrant sur la vue d'ensemble - gérer le stress et l'excitation, et remettre en question ses propres attentes - il a finalement réussi à réduire la consommation d'alcool sans ressentir une telle lutte.
Et il a fait tout cela sans enthousiasme particulier pour la volonté.
Les références
1. Mischel, W., Shoda, Y., et Rodriguez, ML Retard de gratification chez les enfants. Science 244, 933-938 (1989).
2. Carter, EC, Kofler, LM, Forster, DE et McCullough, ME Une série de tests méta-analytiques de l'effet d'épuisement: la maîtrise de soi ne semble pas dépendre d'une ressource limitée. Journal of Experimental Psychology: General 144, 796-815 (2015).
3. Hagger, MS & Chatzisarantis, NL Une réplication pré-enregistrée multi-laboratoires de l'effet d'épuisement de l'ego. Perspectives on Psychological Science 11, 546-573 (2016).
4. Fujita, K. Sur la conceptualisation de la maîtrise de soi comme plus que l'inhibition d'effort des impulsions. Revue de personnalité et de psychologie sociale 15, 352-366 (2011).
5. Magen, E., Kim, B., Dweck, CS, Gross, JJ et McClure, SM Corrélats comportementaux et neuronaux d'une maîtrise de soi accrue en l'absence d'une volonté accrue. Actes de l'Académie nationale des sciences 111, 9786-9791 (2014).