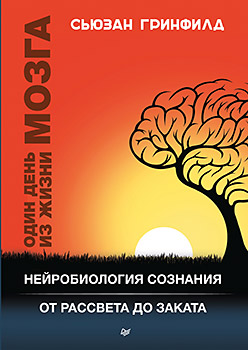
Vous rentrez chez vous, allumez la radio. Vous avez maintenant le temps de prendre un petit déjeuner rapide avec des céréales et une tasse de café chaud. Au cours des vingt prochaines minutes environ, pendant que vous mangez, une stimulation active des oreilles, des yeux, de la langue, du bout des doigts et du nez contrôlera votre esprit. Bien sûr, dans certains cas, la conscience existe sans stimulation explicite des sens - par exemple, dans le processus de méditation ou lorsque vous êtes simplement extrêmement concentré sur une certaine pensée - mais cela nécessite des compétences spéciales. La plupart du temps, les processus qui se déroulent dans l'esprit sont déterminés par ce qui se passe directement autour de vous - cinq sens remplissent continuellement le cerveau d'une multitude de signaux. Les sensations à un degré ou à un autre affectent la conscience à chaque instant d'éveil: elles entretiennent une connexion avec le monde extérieur et vous permettent de vous y déplacer correctement. Revenant à la métaphore avec une pierre jetée dans l'eau, nous posons une question sur laquelle nous nous concentrerons dans ce chapitre. C'est une question de pouvoir: comment les sentiments et les sensations, purs et simples, affectent-ils la conscience? Mais nous rencontrons immédiatement deux problèmes, l'un étant lié à l'espace, l'autre au temps.
CINQ SENTIMENTS: PROPRIÉTÉS SPATIALES DU CERVEAU
Le problème spatial est basé sur la neuroanatomie et réside dans le fait que les signaux de différents sens sont traités différemment. À première vue, tout est simple: soit vous voyez quelque chose, soit vous entendez, vous sentez le toucher, le goût, l'odorat. Nous avons cinq sens à notre disposition, qui sont clairement définis entre eux. Mais même au niveau le plus élémentaire, les zones du cerveau réservées au traitement des signaux de divers sens ne sont pas intrinsèquement spécifiques. Chez l'adulte, divers systèmes sensoriels peuvent même violer les limites anatomiques formelles: le cortex visuel des aveugles, par exemple, est activé par le sens du toucher lors de la lecture du braille. De plus, il est bien connu que si vous perdez la capacité de percevoir l'un des cinq sens, les autres deviennent plus forts. La neuroscientifique Helen Neville a démontré que la surdité améliore la vision et que les personnes sourdes utilisent les zones auditives du cerveau pour traiter les signaux visuels. Pendant ce temps, les aveugles peuvent mieux distinguer les sons que les aveugles, et ils sont capables de déterminer plus précisément l'emplacement de la source sonore. Les personnes malvoyantes sont également mieux développées avec d'autres capacités, telles que la perception de la parole et la reconnaissance vocale. Et dans des expériences sur des animaux privés de la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre organe sensoriel, il a été révélé que ces changements peuvent être colossaux: par exemple, les rats sont en mesure de démontrer une amélioration de l'audition triple après quelques jours dans l'obscurité totale.
Cependant, même sans stimulation directe des sens, le cerveau peut effectuer des tours intéressants dans le traitement des signaux de différentes modalités. Le phénomène de synesthésie (littéralement «association de sentiments») est connu de la science depuis trois siècles. Avec la synesthésie, l'excitation d'un organe sensoriel, que la grande majorité des gens identifie à une seule catégorie de sensations, provoque des sensations selon deux modalités différentes. Par exemple, les couleurs et les formes peuvent être «vues» lors de l'écoute de musique.
Le point ici n'est pas qu'un domaine envahit la sphère de compétence de l'autre, mais plutôt que les connexions entre les zones du cerveau sont inhabituellement abondantes et multiformes: l'activation de l'un - disons, responsable de la reconnaissance des lettres - provoque également l'activation directe d'un autre, apparenté, par exemple , avec reconnaissance des couleurs. Il existe peut-être un mécanisme de blocage entre les différentes parties du cortex, qui devrait fournir une ségrégation de rétroaction claire pour éviter toute ambiguïté, mais, évidemment, cette barrière imprenable est brisée en cas de synesthésie. Si les signaux de rétroaction ne sont pas interrompus de manière typique, puis renvoyés des étapes ultérieures du traitement multicapteurs, ils peuvent affecter les étapes précédentes du traitement jusqu'à ce que les signaux sonores commencent à activer les zones visuelles. Cette désinhibition peut également se manifester dans la présentation clinique d'un certain nombre de troubles, tels que les commotions cérébrales, l'épilepsie du lobe temporal, les accidents vasculaires cérébraux et les tumeurs cérébrales.
Dans tous les cas, l'existence du phénomène de synesthésie, ainsi que la compensation des canaux perceptuels perdus en raison du renforcement des autres, nous conduit à un paradoxe inévitable, mais intrigant: alors que l'expérience subjective de la perception sensorielle est très diversifiée et individuelle, les mécanismes neuronaux qui médient l'acte de perception sont standardisés et interchangeables. . Dès que le signal du monde extérieur est converti en volées de potentiels d'action, ses échos vont instantanément dans différentes parties du cerveau, où ils apparaissent dans les parties correspondantes du cortex, néanmoins similaires dans la structure et le principe du traitement du signal. Il semble que tout soit adapté à un modèle.
Alors, quelle est la différence qualitative dans les expériences subjectives? Comment la formation de l'expérience subjective d'une modalité particulière devient-elle possible? Quelle est la raison d'un tel tri sélectif si les mécanismes de traitement physiologique sont presque les mêmes? Les réponses à ces questions nous aideront à comprendre le lien entre l'objectif et le subjectif, le physique et le mental.
CINQ SENTIMENTS: PROPRIÉTÉS TEMPORAIRES DU CERVEAU
Un autre problème est le sens du temps: les signaux de différents systèmes sensoriels sont traités dans le cerveau à différentes vitesses, mais vous pouvez néanmoins ressentir l'ensemble des sensations en même temps. Vous pouvez entendre le clap et voir les paumes jointes, et vous percevrez ces événements comme simultanés, malgré le fait que le traitement auditif est plus rapide que le traitement visuel. Et si à ce moment vous ressentez une sensation tactile dans la zone du visage - disons, toucher le bout du nez - tous ces événements fusionneront en un moment de conscience multimodal, bien que le signal de votre nez atteigne le cerveau le plus rapidement, car il passe beaucoup moins distance. Cela signifie qu'il existe des fenêtres temporelles qui déterminent un moment de conscience apparemment unifié: une fenêtre est le temps pendant lequel les sensations peuvent se rattraper pour s'unir en un ensemble multisensoriel familier, que nous appelons le «moment de conscience». Votre cerveau doit en quelque sorte synchroniser les événements. Afin d'organiser toutes les différentes modalités sensorielles, il est nécessaire de prévoir les délais appropriés et, bien sûr, le signal sensoriel le plus lent donnera le rythme.
Il s'avère que ces fenêtres temporelles peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de millisecondes. «Nous ne sommes pas conscients du moment factuel du présent. Nous sommes toujours un peu en retard. » Il y a près d'un demi-siècle, le brillant physiologiste Benjamin Libet est arrivé à cette conclusion en étudiant des patients du service de neurochirurgie d'un hôpital local qui avaient un trou dans le crâne foré pour accéder au cortex. Dans l'une des expériences, Libet a utilisé une électrode pour stimuler certaines parties du cerveau, ce qui a provoqué des picotements dans différentes parties du corps. Le patient n'a pas signalé qu'il était au courant du stimulus pendant une période étonnamment longue - jusqu'à 500 millisecondes. Ces demi-secondes sont une éternité à l'échelle des processus cérébraux, étant donné que le potentiel d'action n'est que d'un millième de seconde. De plus, Libet a démontré que lorsque la stimulation était appliquée à une partie éloignée du corps, comme le pied, une période de temps considérable s'écoulait entre le moment où l'événement était enregistré dans le cerveau et le patient réalisait cet événement. Et ce n'est pas seulement l'existence d'une fenêtre temporelle qui garantit un traitement rapide des signaux même les plus lents: la prise de conscience de la conscience semble venir encore plus tard. Des études montrent que lorsque les sujets classent les images présentées dans un ordre aléatoire en catégories (par exemple, «animaux» et «véhicules»), le cerveau reconnaît la différence à un stade précoce du traitement, tandis qu'une solution «consciente» apparaît beaucoup plus tard (plus tard environ 250 millisecondes). Ces périodes fournissent évidemment la réserve de temps optimale pour la formation et la dissolution des ensembles neuronaux.
Les neurones de l'ensemble ne fonctionnent pas comme des câbles téléphoniques isolés qui transmettent indépendamment des informations. Au lieu de cela, l'ensemble est une structure holistique auto-organisée qui fonctionne pendant des centaines de millisecondes. La zone de cette auto-organisation se propage lentement de l'épicentre, comme une ondulation, et ce n'est que lorsqu'elle atteint une zone significative que nous pouvons parler du moment de la conscience. Maintenant, il ne semble pas surprenant que ce processus prenne jusqu'à une demi-seconde.
Mais le problème de l'espace n'est toujours pas résolu. On ne sait pas encore comment la localisation des structures correspondantes du cortex est en corrélation avec les différences subjectives d'audition et de vision. Peut-être que les différences dans la perception des sensations des différentes modalités sont en quelque sorte liées aux différences dans les propriétés des ensembles neuronaux du cortex visuel et auditif, qui n'apparaissent qu'après une certaine période de temps. Dans l'affirmative, nous pourrions identifier la phénoménologie de l'audition et de la vision en utilisant un critère de physiologie objective. Mais comment identifier ce critère?
Il est encore très difficile de comparer la phénoménologie avec ce que nous observons objectivement dans le cerveau. Néanmoins, j'ai une hypothèse. Au sens physiologique, la vision capture principalement (mais pas exclusivement) la différence dans l'arrangement spatial des éléments, tandis que l'audition capture principalement (mais pas exclusivement) les différences temporelles. Ensuite, les caractéristiques spatiales des ensembles neuronaux, changeant sur une certaine période de temps, peuvent nous aider à développer un nouvel ajout aux outils des neurosciences. Idéalement, nous devrions former un critère unique de l'espace-temps, une sorte d'équation mathématique phénoménologique, qui peut également être appliquée à la description de la conscience subjective.
PERCEPTION MULTI-TOUCH
Mais comment fonctionne vraiment la conscience? La perception est-elle la même ou les cinq sens doivent-ils être considérés séparément? Tout le monde conviendrait qu'il existe cinq types de sensations différentes, il serait donc raisonnable de conclure que la conscience est également fractionnaire et que le cerveau prend en charge cinq canaux de traitement indépendants, distinguant clairement cinq catégories distinctes de sentiments, qui contribuent ensuite à la formation de la conscience. Ce raisonnement semble grossier et simple, mais, comme nous le savons, ce point de vue a été défendu par feu Francis Crick et son collègue Christoph Koch, qui ont cherché à identifier les corrélats neuronaux de la conscience séparément pour la perception visuelle, qui était censée exister pleinement indépendamment des autres sentiments.
En 1978, une nouvelle approche de l'apprentissage a été développée sur la base de ce concept. L'idée était de distinguer trois «styles d'apprentissage»: visuel («V»), auditif (auditif) («A») et kinesthésique («K») - «VAK». Le VAK a été proposé à l'origine par les éducateurs américains Rita et Kenneth Dunn il y a plus de trente ans comme un moyen d'expliquer les différences individuelles dans les capacités d'apprentissage des enfants. Sur la base de ce concept, des méthodes ont été développées pour optimiser le processus éducatif. Mais la théorie a évolué beaucoup plus loin, suggérant que certaines personnes par leur nature sont principalement des «visuels», d'autres sont des «publics» et d'autres encore sont des «kinesthésiques».
Néanmoins, aucune étude indépendante n'a trouvé de confirmation de la théorie VAK, et l'enthousiasme du professeur semble être le seul facteur influençant les résultats de l'application de la technique correspondante. Mais pourquoi cette théorie a-t-elle semblé si attrayante pendant longtemps? La justification découle à nouveau de la notion trompeuse de structures cérébrales autonomes, une sorte de «modules», dont chacun remplit sa fonction indépendante. Au cours de millions d'années d'évolution, de nombreuses structures spécialisées ont vu le jour et se sont améliorées dans le cerveau; les gens modernes ont adapté bon nombre de ces structures pour exécuter des fonctions cognitives complexes. Cependant, la preuve de l'échec de la théorie VAK réside dans le fait que ces modules fonctionnels fonctionnent correctement, étant uniquement interconnectés, et ne peuvent pas fonctionner de manière isolée.
L'expérience menée par le neurophysiologiste cognitif Stanislas Dehine sert de confirmation. Il a demandé à ses sujets d'effectuer une série de calculs arithmétiques simples lors d'une scintigraphie cérébrale - par exemple, soustraire sept de cent, puis soustraire sept du reste résultant, et ainsi de suite. Néanmoins, lorsque Dehain a étudié les images obtenues afin d'identifier les zones d'activité significative, il s'est avéré que dans le processus de calculs arithmétiques simples, une douzaine de régions cérébrales différentes étaient impliquées. En d'autres termes, une autre étude a montré que le cerveau fonctionne toujours dans son ensemble.
À partir des signaux visuels entrants, le cerveau crée des «cartes» spatiales du monde. Cela est vrai même pour les personnes aveugles de naissance: leur cerveau crée également de telles cartes. De toute évidence, les aveugles reçoivent les informations initiales non pas visuellement, mais en se concentrant sur le toucher et les sons, mais ces données sont traitées de la même manière que les personnes voyantes. Il existe donc un processus multisensoriel et intermodal dans lequel l'information, qu'elle soit kinesthésique, sonore ou visuelle, est interconnectée et est combinée en une seule image d'information du monde.
Vous avez peut-être remarqué que la lecture des lèvres vous aide à entendre la parole même avec un fort bruit de fond. Les stimuli multisensoriels augmentent l'efficacité du traitement de l'information même dans les parties du cortex qui sont aiguisées par le traitement initial des signaux de la même modalité sensorielle.
Bien que nous puissions distinguer cinq sens différents, notre cerveau, cependant, perçoit généralement l'image entière. Tous les types de pensée incluent un élément d'abstraction. Quelle que soit l'entrée sensorielle par laquelle nous recevons des informations, la conscience met l'accent sur le sens. Un bon exemple d '«abstraction» est une promenade dans la forêt du matin: inhaler de l'air frais et humide, regarder le jeu des reflets du soleil, écouter le bruit des cimes des arbres, vous ressentez d'abord la paix et la tranquillité. Vous ne ressentez aucun besoin de distinguer les sensations individuelles. Le moment de la conscience est plus que la somme de ses composants.
Cependant, il existe une opinion selon laquelle la perception de diverses modalités est en corrélation avec une «quantité» de conscience différente. La vision prend la plus grande part, suivie par le goût, le toucher, l'ouïe et, enfin, l'odorat. Mais le terme «conscience» dans ce cas peut être trompeur. La conscience implique non seulement la gravité de l'expérience sensorielle directe, mais aussi la contribution d'une signification personnelle. Comme l'a très bien remarqué l'anthropologue Clifford Hertz: "L'homme est un animal confus dans les réseaux de significations qu'il a lui-même construit". Par conséquent, il vaut la peine de réviser le classement des sensations - non pas tant en termes de «quantité» de conscience, mais en termes de contexte et de sens.
Prenez la vision, qui, bien sûr, est la plus concrète et la moins abstraite des sens. Le monde qui nous entoure se compose de silhouettes, de motifs, de nuances de reflets et d'ombres, et toutes ces formes colorées ont généralement une signification claire pour nous. Ce que vous voyez, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, «signifie» invariablement quelque chose de personnel pour vous, il y a toujours un contexte. Lorsque vous regardez autour de vous, vous ne voyez pas seulement des couleurs et des formes abstraites, vous accédez à vos souvenirs personnels, associations, sentiments à un certain moment de votre vie: cette pierre sera relativement grande.
Le prochain est le goût. Encore une fois, le contexte sera clair: vous ressentez les propriétés très spécifiques d'un aliment ou d'une boisson. L'un des facteurs déterminant le goût est la comparaison. Dans une étude, les sujets ont évalué un échantillon de limonade en fonction de sa douceur ou de son acidité. Après la première dégustation, les volontaires se sont vu offrir un autre échantillon de limonade, qui contenait moins de sucre et plus de jus de citron. Quand ce fut le tour du troisième verre, qui était en fait identique au premier échantillon, la plupart des gens le considéraient comme le plus sucré des trois. Le goût peut être grandement influencé par la conception du plat, sa consistance et sa température, etc. Et puisque le goût dépend essentiellement des sensations qui l'accompagnent, toutes ensemble détermineront le contexte et, par conséquent, la perception sera également liée à des associations - et encore une fois, c'est une pierre assez grande.
La vision et le goût sont considérés respectivement comme «conscients» à 90 et 80%, mais le terme le plus précis sera «dépendant du contexte». L'intérêt formel n'a pas de sens: ce n'est que leur importance relative par rapport à d'autres sentiments. Le toucher est beaucoup moins sensible au contexte. Le toucher de velours, de soie, d'écorce de bois ou de peau nue peut être ressenti dans diverses situations. Mais généralement, l'importance de cette sensation est importante pour vous ici et maintenant, mais le reste du contexte dans lequel cet objet s'inscrit n'est pas si important. Plus d'attention est désormais portée à la sensation directe d'interaction avec la surface: cette pierre est beaucoup plus petite, et la puissance du lancer devient extrêmement importante.
Ensuite, le toucher suit l'audition. Par rapport à la vue, au goût et au toucher, l'ouïe est plus passive et moins sensible au contexte. Le son vous trouve toujours, et non l'inverse. Moins de filets requis. C'est la capacité d'entendre qui disparaît en dernier sous l'influence de l'anesthésie générale, et revient également en premier lorsque le patient se réveille. Cette pierre est petite et le pouvoir de lancer est de la plus haute importance.
Enfin, l'odorat. De tous les sens, c'est le plus dépourvu de contexte. Fait intéressant, la perte de l'odorat est l'un des premiers signes de la maladie d'Alzheimer, car la voie reliant le nez et le cerveau va directement au «système limbique». Le système limbique est un vaste groupe de structures cérébrales qui est associé aux premiers stades des processus de mémoire et, surtout, aux émotions. Par conséquent, il n'est pas surprenant que l'odeur puisse provoquer des émotions aussi fortes et immédiates, étant la plus primitive de toutes les sensations. , , — , , , , . , , , , . . . , , «» .
. , . . , , . , , . , . , , , . , . , — .
. , , , . — — . , , . , .
« ( ), , , ». . , , .180 , , , , , - , .
— . « », « », , — , ? , , , , , , .
, , , . , , : , « ». , , . , . , . , .
, , . , , , , : « ». , , , , , . ?
, , . : , - . - — , . « - , ».
, , . , 3, « — , », . , , .
, , , , , , . , . , , . , «» , . , , , — .
, . , . . , -, — «», - . «» , , .
, , , . , , , , . .
, , , , . , , , , : . : , . , .
, , , . , . — . , , : , . : « . -. ». : « , — ».
, — , — . , , , , . , , .
« », , , , , , ?
Mais vous ne faites pas attention à toutes ces fraudes de votre cerveau. Vous sentez seulement que Mozart remplit vos oreilles, maîtrisant sans vergogne la conscience, provoquant une tempête de sensations dans une séquence arbitraire et illogique, tandis que les yeux, les bras et les jambes existent comme s'ils étaient autonomes. Mais soudain, quelque chose envahit votre conscience. Votre précieux monde intérieur, rempli de musique, s'estompe à l'arrière-plan - vous êtes à la porte de votre bureau.»Vous trouverez plus d'informations sur le livre sur le site Web de l'éditeur» Table des matières» Extraitpour les épargnants 20% de réduction sur le coupon - Cerveau